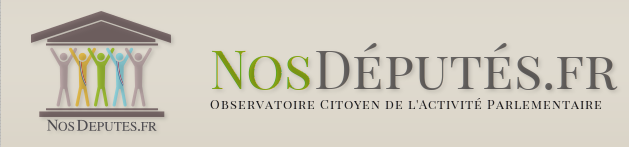Intervention de Jean-François Coulomme
Séance en hémicycle du mardi 30 avril 2024 à 15h00
Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise — Motion de rejet préalable
 Jean-François Coulomme :
Jean-François Coulomme :Pour prendre la mesure de l'imposture, laissons les chiffres parler d'eux-mêmes : en 2023, la France comptait 15 millions d'entreprises, dont 98 % de TPE et PMI dépourvues de direction juridique ; seulement 2 % d'entre elles – les grands groupes – en sont pourvus. Vous voulez discuter de la création d'un avantage exorbitant au bénéfice des plus grosses entreprises qui, non contentes d'être déjà les plus riches et les plus puissantes, disposeraient ainsi de l'ultime privilège de la confidentialité, au détriment de toutes les autres. Pas de doute, ce texte vient bien des bancs de la Macronie : il s'agit de donner toujours plus aux plus puissants et de déséquilibrer davantage le marché des affaires à leur profit.
Il y a quelques mois, le Conseil constitutionnel a censuré le même dispositif prévu par la LOPJ. Vous passez outre cette censure, outre les avis de la majorité des professionnels, des autorités administratives et des instances judiciaires et, plus globalement, outre toutes les alertes signalant les dérives de la réforme, tout cela pour 2 % des entreprises qui sont déjà parmi les plus favorisées, soit parce qu'elles sont, pour la plupart, en position monopolistique, soit parce qu'elles profitent de transferts d'argent public qui ne servent qu'à conforter les dividendes de leurs gros actionnaires.
Par quoi une telle obsession à créer ce superprivilège est-elle animée, sinon le désir de soustraire les grosses entreprises à l'action de la justice française, sachant que cela ne renforcerait pas pour autant ce que vous adorez appeler la « compétitivité à l'international », puisque la confidentialité – alors même qu'il s'agit d'un argument central dans vos explications – ne sera ni opposable aux instances européennes ni à celles des États-Unis ?
Vous justifiez la proposition de loi en prétextant l'attractivité et la compétitivité à l'international des entreprises françaises. Votre texte prétend s'aligner sur une pratique courante au-delà de nos frontières. Arrêtons-nous un instant sur cet argument fallacieux.
Un tel prétexte n'est pas recevable car la France se classe, pour la quatrième année consécutive, à la première place des pays les plus attractifs d'Europe en matière d'investissements étrangers. L'argument périmé de la potentielle délocalisation des directions juridiques, si cette réforme n'était pas adoptée, est, quant à lui, faux : toutes les directions juridiques des grosses entreprises françaises sont implantées en France, ce que vous savez parfaitement puisque l'audition des membres de l'Autorité de la concurrence l'a démontré. Surtout, cet argument ne tient pas juridiquement car une direction juridique est requise pour chaque entité nationale, cette direction devant nécessairement se situer dans le pays concerné. L'argument s'apparente donc à une tromperie.
De plus, la France ne fait pas exception au sein de l'Union européenne. C'est une idée reçue. Un grand nombre d'États ne reconnaissent pas ce legal privilege et quand elles en reconnaissent un, il est incomparable à celui que prévoit cette réforme puisqu'il est le corollaire d'une profession indépendante : soit un juriste qui relève d'une profession réglementée, soit un avocat inscrit dans un barreau. Si un tel privilège de confidentialité venait couronner les efforts du Medef pour le faire adopter par la représentation nationale, la France serait, au contraire, une exception au sein de l'Europe.
L'instauration du legal privilege à la française ne sera pas opposable aux autorités européennes, qui refusent de reconnaître une confidentialité aux documents émanant de juristes ou d'avocats d'entreprise. Je vous renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne – dans son arrêt Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre Union européenne, rendu le 14 septembre 2010 –, que vous n'êtes pas sans connaître.
La confidentialité ne sera pas davantage opposable aux autorités américaines car elle est incompatible avec les droits américains en la matière, dont certains ont une portée extraterritoriale.
Ce superprivilège ne sera finalement opposable qu'aux autorités françaises, et bien entendu à tout plaignant, personnes morales ou physiques. Se loge ici le réel moteur de cette réforme : soustraire les grosses entreprises à l'action de la justice française.
Cette proposition de loi constitue une entrave à l'action de la justice. L'introduction d'un tel privilège offrira aux entreprises un argument légal pour refuser que soient produits les documents qui pourraient leur nuire dans toutes les procédures – aux seules exceptions des procédures pénales et fiscales –, au mépris du droit à la preuve pourtant garanti, comme l'a récemment rappelé l'assemblée plénière de la Cour de cassation, par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Quoique bienvenue, l'exclusion des matières pénales et fiscales de ce superprivilège est insuffisante et hypocrite. Un grand nombre de contentieux ne sont en effet jugés pénalement, devant le parquet national financier (PNF), qu'à l'issue d'une enquête administrative diligentée par l'une des autorités administratives indépendantes qui assurent un suivi permanent des marchés grâce aux systèmes d'alertes automatisées dont elles disposent. Alors qu'elles ouvrent actuellement un grand nombre d'enquêtes, transmises ensuite au PNF, les AAI pourront désormais se voir opposer la confidentialité. Une telle loi aurait ainsi pour conséquence d'empêcher de nombreux contentieux d'être identifiés puis transmis au PNF. Vous avez beau exclure le domaine pénal de la confidentialité, la réforme dégraderait donc drastiquement le traitement des contentieux pénaux, ce qui prouve le caractère totalement artificiel de la séparation entre, d'un côté, les activités pénale et fiscale et, de l'autre, les domaines civil, administratif, commercial ou prud'homal.
La réforme entraverait les pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction des autorités administratives indépendantes, alors que leur pouvoir de régulation est nécessaire pour garantir que l'économie soit tournée vers l'intérêt général, dans le respect de l'ordre juridique dans lequel elles interviennent. À ce titre, il est fondamental que ces autorités de régulation continuent de disposer d'un libre accès à tous les documents internes des entreprises.
En outre, la capacité de saisir des pièces des juridictions civile, prud'homale, commerciale et administrative est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la justice française, autant qu'elle est nécessaire pour assurer l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi. En n'excluant pas ces matières de la confidentialité, on entraverait la capacité des juges à mener leurs investigations, donc on porterait atteinte à l'État de droit. L'accès à la preuve est fondamental dans toutes les procédures, pas seulement dans les procédures pénales et fiscales. L'ensemble des contentieux risqueraient ainsi de subir une « pénalisation » dans le seul but, légitime, d'obtenir un accès à la preuve, avec pour conséquence l'engorgement des juridictions pénales. Les matières exclues de ce superprivilège sont donc en nombre insuffisant, ce qui donne un avantage certain aux entreprises vis-à-vis des juridictions et porte atteinte au droit à un procès équitable.
La possibilité de lever la confidentialité ne rend pas le texte plus satisfaisant ni acceptable. Une telle garantie est insuffisante – de la poudre aux yeux – eu égard aux enjeux économiques et politiques de la réforme. La confidentialité prive en effet la partie adverse d'informations clés et engendre une rupture d'égalité – renforcée par la restriction du délai de recours. Le délai de quinze jours est en effet insuffisant et déconnecté de la réalité des délais de traitement en juridiction. Il revient à réduire presque intégralement la possibilité d'une telle levée de confidentialité.
Tout cela en dit long sur l'esprit de ce texte qui sacralise une confidentialité dont la levée est illusoire et permet à la quasi-intégralité des consultations juridiques d'échapper aux autorités françaises, selon le bon vouloir des entreprises. Il s'agit bien, une nouvelle fois, de garantir le secret des affaires au profit des grandes et grosses entreprises.
À toutes ces alertes et critiques s'ajoute le problème central du statut des juristes d'entreprise, à propos duquel le vice-président de l'Institut des juristes d'entreprises de Belgique a émis de vives critiques lors de son audition par la commission des lois. Un juriste d'entreprise est par définition un salarié soumis à son employeur par un lien de subordination. Son indépendance est tout simplement illusoire car qui paye l'orchestre choisit la musique. Sans indépendance, quelle déontologie pouvons-nous attendre ? Pour que la déontologie existe, il faut que quelqu'un puisse la contrôler et sanctionner les manquements, sinon elle n'est qu'un leurre – ce que sont exactement les « règles éthiques » mentionnées par cette proposition de loi. Qui établit ces règles ? Quelle instance les fait respecter ? Sur quel fondement ? Qui sanctionne les infractions ? Aucune réponse n'est donnée. Ceci est plus que flou. Cet aspect ne vous préoccupe guère, et pour cause : seul l'intérêt des grandes entreprises vous importe, non l'intérêt général et le respect des principes fondamentaux.
Pour les avocats, qui sont indépendants, le secret professionnel est un droit impératif qui garantit le respect de la vie privée et le bon déroulement de la justice. Le secret professionnel du juriste d'entreprise, quant à lui, serait un droit au profit de l'entreprise, de la direction et des actionnaires, ce qui est par nature incompatible avec une quelconque indépendance. Là est toute la différence avec la profession d'avocat.
Enfin, toute entreprise pourra, à son gré, lever la confidentialité, si cela permet aux dirigeants de se dédouaner sur les juristes d'entreprise qui auront fourni les documents jusqu'ici confidentiels. Le texte ne protège en rien le salarié juriste, au contraire.
Pour toutes ces raisons, qui ne traduisent pas les fantasmes des Insoumis mais correspondent aux alertes concrètes exprimées par une majorité de professionnels, nous nous opposons au texte au moyen de la présente motion de rejet préalable. Nous espérons que votre sens de la justice et votre attachement aux principes fondamentaux qui la constituent, vous pousseront, chers collègues, à faire preuve de bon sens, en votant cette motion.